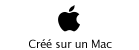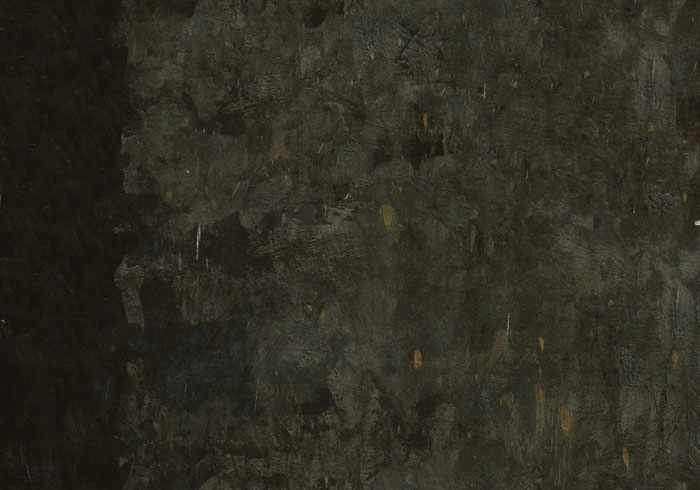
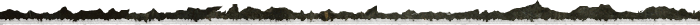

Crevé, voilà que je viens de crever, cela fait la troisième fois en cette fin de journée. Pas de chance et comme par hasard je suis le dernier, les autres sont loin devant. Le fond de la vallée me paraît lointain encore.
La première fois c’était juste avant le retour sur la petite ville de Calca. Ce n’était pas grave car je venais de rejoindre le bitume et la route descendait légèrement. Bien sûr tous les passants croisés, jeunes comme vieux, se sont gentiment moqués de mon équipage dont le bruit un peu flasque, irrégulier, métallique parfois et la trajectoire hésitante, comme ivre, ne pouvaient qu’attirer l’attention vers moi. Mais les sourires, voire les moqueries exprimaient la bonne humeur et m’aidaient à supporter cette situation peu glorieuse. Il faut dire que depuis 4 ans, la population locale s’est accoutumée à voir passer ces « bicicletas » bizarres et leurs adeptes, casqués et cuirassés comme des guerriers sortis d’une BD futuriste. A cette époque, pourtant pas si lointaine, les quelques Européens et nord américains venus dans la Vallée de l’Urubamba pour la première Méga de Cusco en janvier 2005 faisaient figure de précurseurs vis-à-vis des rares initiés locaux et de leurs machines rudimentaires, mises au rebut depuis longtemps chez nous. Aujourd’hui, il n’en est plus de même et si parfois on croise un « campesinos » à vélo, malgré un usage différent, on se sent tout de suite frère. Pourtant je revenais de loin, plutôt de haut. Le bus, affrété par Gustavo Mathus, le George Edwards sud-américain, m’avait conduit, ainsi que mes compagnons américains, argentins, équatoriens, espagnols et slovaque, aux confins de cette vallée à quelque 4600m d’altitude. Notre bus venait de gravir une impressionnante piste de terre qui s’élevait lentement entre les versants resserrés de la montagne pour ensuite entailler les flans plus larges d’un haut plateau glaciaire, cultivé et habité jusqu’à plus de 4000m. Cette situation nous étonne toujours, habitués au relief quasi désertique de nos Alpes à hauteur équivalente. Cette vaste chaîne de montagnes déchiquetées dont la vigueur des formes atteste de sa jeunesse et de sa nature volcanique, enferme l’horizon d’une barrière noirâtre quasi infranchissable. Le moindre sommet dépasse les 5000 m. Dans ce cirque grandiose, l’incontournable Lama règne en maître incontesté des clichés photographiques. Des cahutes en pierres sèches, recouvertes de chaume et ceinturées d’enclos pour le bétail, indiquent la présence humaine. Petits bergers d’à peine 6 ou 8 ans, paysans, hommes et femmes tous arborent ces vêtements de couleurs rouge vif, aux motifs géométriques et ces coiffes si étranges parées de lanières de tissu multicolore pour les hommes et de galettes en forme de saladier orné de broderies pour les femmes. Tous vont pieds nus, dans des sandales confectionnées le plus souvent dans des carcasses de vieux pneus. Il faut dire que le climat, particulièrement humide en cette saison automnale et les nombreuses fondrières boueuses ne favorisent pas le port de chaussures fermées qui, une fois imbibées d’eau, mettraient trop de temps à sécher.
Enfin, après plus d’une heure d’ascension, le bus atteint le col et s’arrête. Ici commence notre descente. Pour un premier contact avec les pistes andines, il ne faut pas hésiter à libérer les poumons. La densité de l’air est moindre et les rampants que nous sommes, éprouvons à cette altitude des difficultés à respirer. En fait les échanges gazeux indispensables à l’irrigation du cerveau et des différents organes se fait moins bien en raison d’un air moins dense, donc moins riche en oxygène, malgré un taux de saturation constant. A voir les populations locales courir à travers les pairies, on se dit qu’il doit y avoir un truc. En fait ils possèdent naturellement un taux d’hématocrite supérieur au nôtre, d’où une compensation à la pénurie d’oxygène. Pour nous, habitants des plaines, il faudra attendre quelques jours adaptation, voire 2 semaines pour que notre organisme fabrique naturellement les globules rouges manquants. En attendant, la seule méthode est de faire tout lentement, en demi-régime en quelque sorte. Le risque est de faire un mal des montagnes, le Sorroche des andins. Eudème cérébrale ou pulmonaire peuvent survenir ; mais plus fréquemment le phénomène se manifeste par de légers étourdissements, maux de tête, poitrine oppressée, manque de souffle, épuisement rapide. T’es épuisé à la simple idée de mettre le pied à terre. Mais quoi, on y est venu, alors allons-y !
Rapidement les machines sont descendues du toit du bus. Malgré un voyage parfois chaotique, aucun vélo n’a subit de dommage. Il faut dire qu’en l’absence de dispositifs spécifiques, les sud américains ne manquent pas d’imagination pour transporter nos précieux deux roues sur ou après tout ce qui roule. En l’occurrence, le chauffeur a aligné nos engins par le travers sur le toit du bus. Une corde, plutôt une cordelette, unit chaque cadre par un tour mort, le tout étant arrimé, que dis-je ficelé à la traverse frontale et arrière de la galerie. C’est curieux de voir tous ces vélos debout sur le toit. Ça ferait un bon sujet de dessin humoristique, mais c’est efficace. Il faut juste faire attention à ne pas accrocher les guidons à un câble électrique, foisonnants au voisinage des habitations.
Au moment de partir, un paysan péruvien qui vient de gravir le col en pancho et chapeau à franges s’arrête, à peine essoufflé, un grand sourire aux lèvres. Anne, notre volubile américaine, s’avance vers lui et lui propose de troquer son « épitête » contre son casque intégral. On fait une photo, tout le monde est heureux rien qu’à l’idée du formidable trip qui nous attend dans cette vallée sacrée des Incas. Plus de 1000m de descente freeride et en plus il fait beau.
Les premiers tours de roue sont précautionneux, la pente, en fait un talus d’éboulis de nature schisteuse aux blocs acérés comme des lames de rasoir, est forte et vite accidentée. Pas question de tomber, une évacuation serait des plus problématiques. Aussi tout le monde s’est équipé de gants, casques, genouillères et gilets renforcés y compris les péruviens ; pas fous ! La piste n’est nullement préparée et s’avère parfois chaotique. Alternent passages à flan de montagne, prairies couvertes d’une herbe rase dans laquelle la trace se perd rapidement, cuvettes gorgées d’eau où descendre de vélo équivaut à prendre un bain de pied, portions aménagées de rigoles empierrées qu’il faut absolument sauter si on ne veut pas pincer. Cependant le plaisir de la glisse est permanant. Peu de relances, il n’y a qu’à se laisser aller sans cependant perdre le contrôle. Les changements sont brutaux. D’une trajectoire fluide, on déboule sur un tape-cul rocheux à haute fréquence. Mais qu’importe, on a tout ce dont peu rêver un bikonaute : des sensations, de la vitesse, de l’improvisation, de l’adresse. Repérer au loin le bon passage, là réside le secret. Et cette nature, austère mais grandiose, sauvage mais nourricière emplit la mémoire de sensations qui inondent le cœur de la jouissance de l’instant présent. Oui, le bonheur est bien sur le chemin. Les Incas n’ont-ils pas inventé l’expression « pachamama » qui désigne à la fois la terre et la mère. Qu’elle meilleure relation ne peut-il y avoir que celle qui existe entre l’être et cette terre qui l’a vu naître, le porte, le nourrit et finalement l’engloutit.
A mesure de la descente, les champs alentour témoignent de la présence active de ces populations quechua, héritières du patrimoine génétique des incas. Ces campesinos, outre l’élevage extensif de moutons et de lamas, cultivent le maïs, le meilleur qui soit, sans ces saloperies de gênes trafiqués, ainsi que la pomme de terre, là aussi d’une qualité et d’une variété inouïe. Si la France s’enorgueillit de posséder plus de 300 sortes de fromages, que dire du Pérou avec ses 350 variétés de tubercules. Une tout les 100m d’altitude gagnée. Les marchés en regorgent et déguster une purée locale me procure un réel plaisir gastronomique.
Le sentier en légère pente, bien tracé, emprunte une large plateforme qui témoigne d’un travail de terrassement ancestral. Nous éprouvons ce sentiment de griserie dû à la vitesse. Debout sur les pédales, le regard porté loin devant, la bouche entrouverte, nous avalons littéralement cet air pur et vivifiant si précieux à nos organismes peu accoutumés à un tel exercice en haute altitude.
A peine le temps de lancer un « Ola ! » à un groupe de campesinos, pantois, curieux de notre équipage. Pourtant leur occupation aurait dû nous interpeller. Leurs outils notamment témoignent de l’ancienneté de leur technique, un long manche fin et légèrement incurvé, de 2m50 environ, à l’extrémité duquel est ficelé une sorte d’ergot faisant office de point d’appuis. Au bout, une lame de fer d’une cinquantaine de centimètres, effilée comme un couteau, vient s’emmancher. Patiemment ils retournent cette terre brunâtre, riche, fertile, porteuse de leurs projets.
Une telle randonnée ne se résume pourtant pas un enchaînement continu de glissades champêtres. Ne pas oublier les machines et leur capricieuse mécanique. Un vélo, c’est basique et pourtant ça manifeste parfois de la mauvaise humeur. Le point faible, outre les pneumatiques, c’est le dérailleur ou plutôt la fameuse patte de dérailleur. Je ne comprends pas pourquoi les constructeurs s’ingénient à nous fabriquer de tel objet aussi fragile. Ne jamais partir sans au moins une ou deux pattes supplémentaires. C’est petit et ça pèse quasiment rien, mais quant elle casse, adieu les sensations, bonjour la galère. Bon cette fois-ci l’astuce de nos guides péruviens aura raison du problème. Juste le temps d’un petit arrêt, histoire d’une causette et surtout de photographier un troupeau de lamas, le nez au vent, l’œil inquiet, les oreilles dressées comme des radars, un jour d’alerte aérienne.
Progressivement la vallée se resserre, la piste devient de plus en plus étroite, prise entre les flancs de la montagne. Peu à peu elle s’enfonce dans une enfilade rocheuse où le torrent peine à se frayer son lit. La dernière fois que j’étais passé par là, l’orage grondait, la pluie s’était mise à tomber. La pente et le relief du sol rendu glissant ôtaient tout espoir de pouvoir s’arrêter, d’autant que mes freins à patins refusaient de faire leur office. Une seule attitude, continuer, en espérant éviter la chute. Aujourd’hui le ciel, bien que blanc, nous accorde sa clémence. L’occasion de profiter du plus spectaculaire passage. Un chemin très descendant, à peine plus large que 1m50, taillé dans la falaise, barré de marches irrégulières et de blocs rocheux affleurants. Aucun garde-fou. L’occasion de saisir quelques belles prises de vue qui témoigneront de notre épopée. Anne manque même de verser dans le ravin ; instant de petite frayeur que son instinct de survie a vite recadré. Après une portion de pavasses bien cassantes, agrémentées de deux belles épingles requérant un peu de technique, nous voilà rendus au fond des gorges. La traversée du torrent, grossi des pluies intermittentes qui ne cessent de s’abattrent sur un versant ou l’autre de cette haute vallée, nous franchissons deux ponts de bois. L’occasion de stopper notre trip pour admirer ce paysage chargée de symbolique sacrée inca. En effet ce lieu retiré servit de cimetière aux anciens. Cimetière troglodyte, puisque les caveaux se réduisent à de simples niches excavées dans la paroi rocheuse. Peu enclins à une rêverie poétique, nous poursuivons notre chemin, avide de sensations plus sportives. A présent il n’y a de place que pour les eaux impétueuses du torrent et un étroit passage empierré et détrempé. Pas question d’un faux pas, un bain ici ne serait pas vraiment une bonne idée.
Au sortir des gorges, le paysage change progressivement. On a perdu beaucoup d’altitude à en juger par la végétation plus luxuriante. L’eucalyptus règne ici en maître. A la fois bois de chauffage et de construction cet arbre vivace, accepte d’être coupé à sa base et de repousser sans complexe, donnant des fûts bien droits. C’est l’arbre de prédilection de toute l’Amérique du sud. une sorte de cadeau de la Nature.
Après une longue ligne droite, on pénètre dans un hameau. Une petite fillette, blottie contre le garde-corps d’un pont, admire la troupe, le regard songeur d’un ailleurs au bout du chemin. Ce qui est frappant quand on découvre pour la première fois les populations locales, c’est la petite taille des enfants. De vraies poupées, au visage rond, la peau brune, les joues écarlates, la pupille noir autant que les cheveux. Habillés des vêtements traditionnels, où le noir et le rouge sombre dominent, coiffés d’un bonnet multicolor ou pour les filles du chapeau galette traditionnel (voir s’il y a un nom), ces enfants s’activent dès le plus jeune âge aux petits travaux agricoles et notamment au gardiennage des troupeaux. Il est fréquent de voir au bord des chemins ou en pleine campagne de minuscules cahutes de pierres sèches, couvertes d’une toiture de chaume ou d’une simple bâche de plastique. Ces constructions rudimentaires, de forme triangulaire, ouvertes sur une face, font office d’abris pendant les averses. En voir sortir l’un de ces gosses, au passage d’une voiture ou d’un car est toujours surprenant et quelque peu émouvant. Surtout quand on croise leur regard et qu’on ressent leur espoir de vous voir vous arrêter. leur image contre quelque soles traînant au fond de votre poche. On ne peut pas dire qu’il s’agisse véritablement de mendicité. Ce n’est pas le sentiment que procure ce type de relation mais bien plutôt une sorte d’échange commerciale. Je te laisse me photographier, tu me donnes une pièce. Pas si bête ! Pourquoi pas ?
lundi 7 avril 2008
Un BIKONAUTE AU PAYS DE L’INCA®